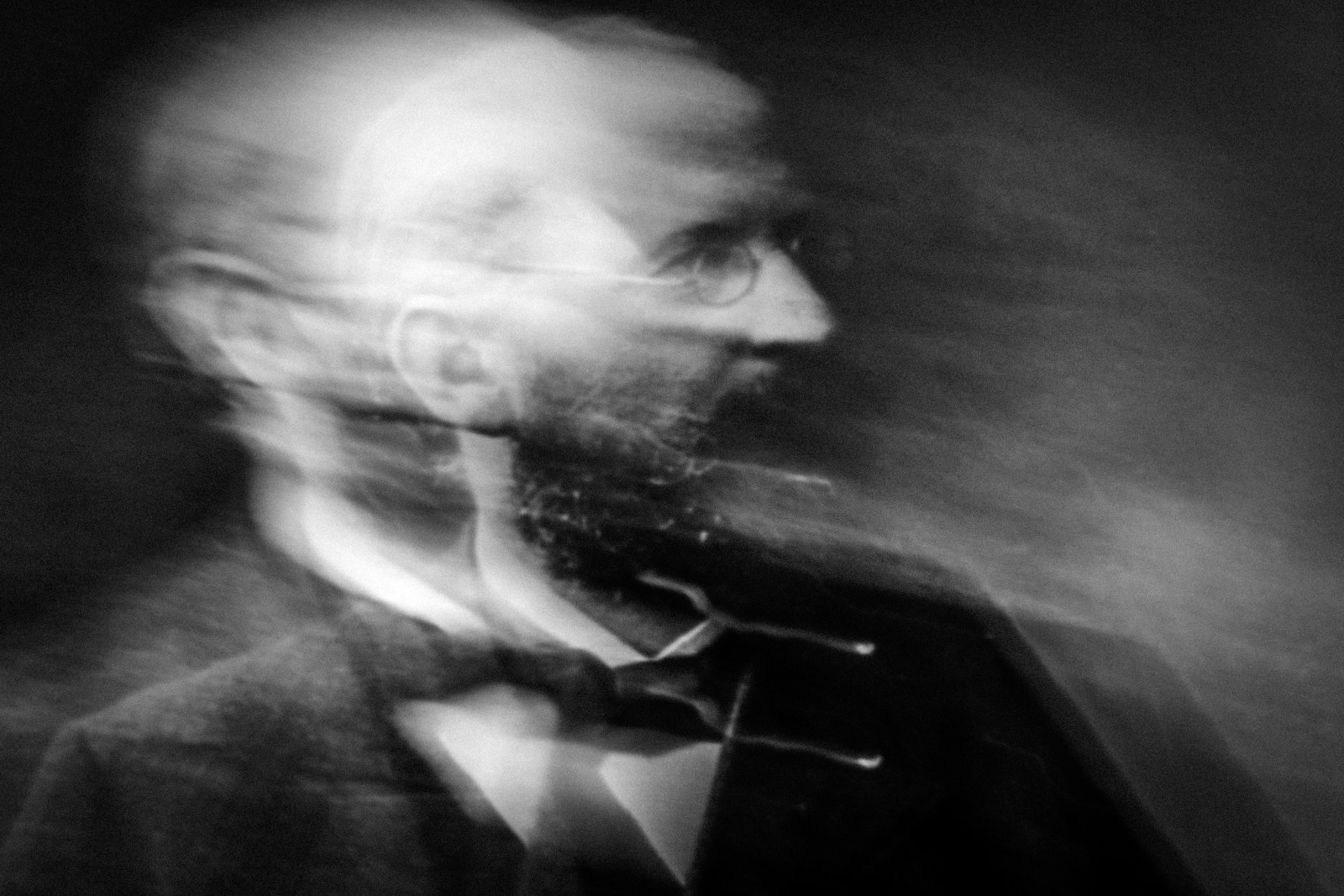-
Quand les socialistes pensaient le socialisme [en cours]
Peut-être est-il temps de sortir du chaudron de l’histoire les figures, désormais fanées, de ceux qui ont pensé, débattu et défendu le socialisme, afin de refonder ses valeurs en fonction du présent et pour affronter l’avenir. La photographie ne peut que restituer leurs visages fanés par le temps et rappeler leurs noms. Leur pensée est toujours présente dans les mots imprimés sur le papier il y a plus de cent ans.
© Francesco ACERBIS / Divergence
-
Portrait d'Antonio Gramsci au début des années 1920. Antonio Gramsci (1891-1937) est un philosophe, écrivain et homme politique italien, figure majeure du marxisme. Cofondateur du Parti communiste italien en 1921, il élabore des théories sur l’hégémonie culturelle et le rôle des intellectuels dans la société. Opposé au fascisme de Mussolini, il est arrêté en 1926 et passe plus de dix ans en prison, où il écrit ses célèbres Cahiers de prison. Ses idées ont profondément influencé la pensée politique et sociale du XXe siècle. Gramsci meurt en 1937 des suites de sa détention

-
Portrait de Rosa Luxemburg en 1911. Rosa Luxemburg (1871-1919) est une théoricienne marxiste, révolutionnaire et militante socialiste d’origine polonaise. Figure clé du socialisme international, elle s’oppose à la Première Guerre mondiale et milite pour une révolution ouvrière. Cofondatrice de la Ligue spartakiste et du Parti communiste d’Allemagne (KPD), elle critique à la fois le réformisme social-démocrate et l’autoritarisme bolchevique. En 1919, lors de l’insurrection spartakiste à Berlin, elle est arrêtée et assassinée par des paramilitaires. Son héritage intellectuel reste influent dans les débats marxistes.

-
Portrait de Karl Marx réalisé par le photographe anglais John Mayall peut aprés l'année 1870. Karl Marx (1818-1883) fut un philosophe, économiste et théoricien politique allemand, fondateur du matérialisme historique. Son analyse du capitalisme, exposée dans des œuvres comme Le Capital (1867), repose sur le concept de lutte des classes comme moteur de l’histoire et sur une critique du système économique basé sur le profit et l’exploitation du travail salarié. Avec Friedrich Engels, il rédigea Le Manifeste du Parti communiste (1848). Exilé une grande partie de sa vie, ses théories ont profondément influencé la pensée politique et économique moderne.

-
Portrait de Mikhail Bakunin réalisé par Nadar vers 1860. Mikhail Bakunin [Mikhaïl Bakounine]. (1814-1876) Philosophe et révolutionnaire russe, l’un des principaux théoriciens de l’anarchisme. D’abord influencé par le socialisme de Hegel, il s’opposa au marxisme, rejetant l’autoritarisme et prônant la destruction de l’État comme condition à la liberté. Partisan de l’action directe et de la révolution sociale, il participa à plusieurs insurrections en Europe. Son œuvre, comme Dieu et l’État, a profondément marqué les mouvements anarchistes et antiautoritaires du XIXe siècle.

-
Portrait de Jean Jaoures réalisé à Moteviedeo en 1911. Jean Jaurès (1859-1914) est une figure majeure du socialisme français. Philosophe et homme politique, il milite pour la justice sociale, l’unité ouvrière et la paix internationale. Député, il fonde L’Humanité en 1904, journal engagé. Son assassinat, le 31 juillet 1914, marque la veille de la Première Guerre mondiale et fait de lui un symbole du combat pour la paix et l’égalité.

-
Louise Michel photographiée par Ernest-Charles Appert à la prison des chantiers à Versailles en 1871. Louise Michel (1830-1905). Militante anarchiste française, écrivaine et figure centrale de la Commune de Paris (1871). Enseignante engagée, elle défendit l’éducation pour tous et l’égalité sociale. Après la répression de la Commune, elle fut déportée en Nouvelle-Calédonie, où elle soutint la cause des Kanaks. Théoricienne de l’anarchisme, elle prônait la révolution sociale, l’abolition de l’État et la solidarité internationale. Ses écrits et discours ont marqué le mouvement anarchiste et féministe du XIXe siècle.
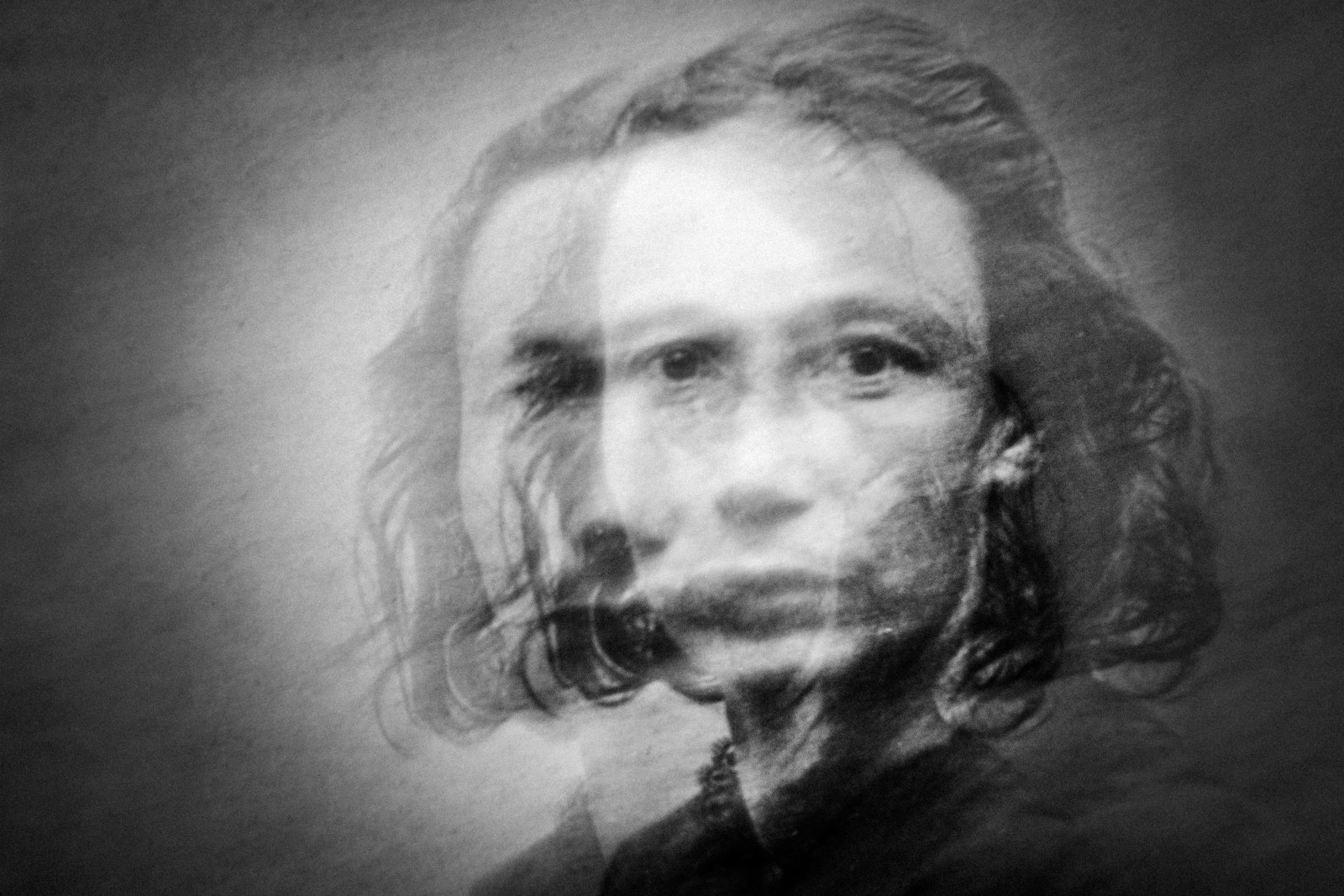
-
Portrait de Lev Trotski en aout 1940. Lev Trotski (1879-1940) fut un révolutionnaire et théoricien marxiste d’origine russe, l’un des principaux dirigeants de la Révolution d’Octobre de 1917 et une figure clé du régime bolchevique. Commissaire du peuple à la guerre, il joua un rôle déterminant dans la victoire des Bolcheviks pendant la guerre civile russe. Défenseur de l’internationalisme et de la révolution permanente, Trotski s’opposa à la bureaucratisation du régime soviétique sous Joseph Staline. En raison de ses divergences politiques, il fut exilé en 1929 et assassiné au Mexique en 1940 sur ordre de Staline. Son héritage reste celui d’un militant révolutionnaire et d’un intellectuel marxiste radical.

-
Portrait de Karl Liebknecht réaliser à Berlin vers 1911. Karl Liebknecht (1871-1919) Intellectuel, avocat et militant politique allemand, figure clé du marxisme révolutionnaire en Allemagne. Membre du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), il s’opposa vigoureusement à la Première Guerre mondiale, ce qui lui valut plusieurs emprisonnements. En 1916, il rompit avec le SPD en raison de son soutien à l’effort de guerre et participa à la création de la Ligue spartakiste. Après la Révolution allemande de 1918, Liebknecht, avec Rosa Luxemburg, fonda le Parti communiste d’Allemagne (KPD). Il fut tué lors de l’insurrection spartakiste en janvier 1919, devenant ainsi un martyr pour le mouvement communiste.

-
Portrait de Vladimir Lenin réalisé en 1920 par Pavel Jounkov. Vladimir Ilic Lenin [Vladimir Ilitch Lénine] (1870-1924). Théoricien marxiste, révolutionnaire russe, leader de la Révolution d’Octobre (1917) et fondateur de l’Union soviétique. Il adapta le marxisme au contexte russe en développant le léninisme, basé sur le rôle central du parti, la dictature du prolétariat et la transition vers le communisme. Dans des œuvres comme Que faire ? et L’État et la Révolution, il défendit la nécessité d’une rupture révolutionnaire.
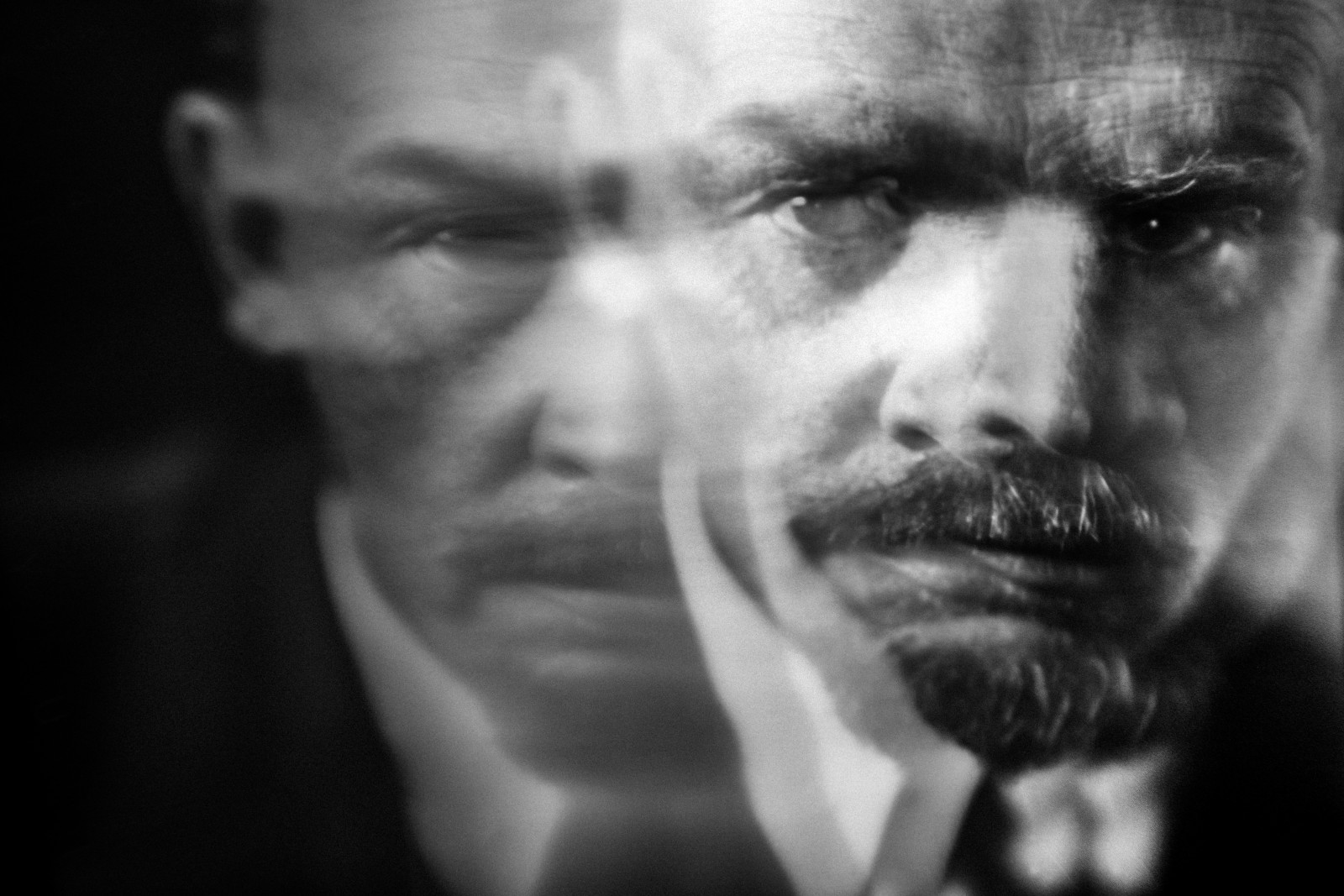
-
Portrait de Friedrich Engels réalisé par William Hall em 1877. Friedrich Engels (1820-1895). Philosophe, sociologue allemand, collaborateur de Karl Marx. Cofondateur du marxisme, il coécrit Le Manifeste du Parti communiste (1848) et soutient financièrement Marx. Son œuvre majeure, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), analyse les structures sociales. Engels a joué un rôle clé dans la diffusion des idées marxistes et la publication de Le Capital après la mort de Marx. Il reste une figure centrale de la pensée socialiste.

-
Anna Kuliscioff (1857-1925) fut une révolutionnaire, médecin et militante socialiste russe, naturalisée italienne. Issue d’une famille juive aisée, elle adhéra aux idées anarchistes et socialistes dans sa jeunesse, avant de s’exiler en raison de son activisme politique. Étudiante en médecine, elle devint l’une des premières femmes médecins en Italie, se spécialisant en maladies infectieuses. Active dans le Parti socialiste italien, elle lutta pour les droits des travailleurs et des femmes, en particulier pour le suffrage féminin. Intellectuelle influente, elle collabora avec Filippo Turati, avec qui elle partagea vie et engagement politique.

-
Portrait de Filippo Turati réalisé en 1920. Filippo Turati (1857-1932). Homme politique, journaliste et écrivain italien, figure clé du socialisme italien. Cofondateur du Parti socialiste italien (PSI) en 1892, il milite pour les droits des travailleurs, la justice sociale et les réformes démocratiques. Opposé à la violence révolutionnaire, il prône un socialisme réformiste. Turati s’oppose au fascisme de Mussolini, ce qui le contraint à l’exil en France en 1926. Il meurt à Paris en 1932, laissant un héritage de lutte pour la liberté et la démocratie.

-
Portrait de Sylvia Pankhurst en 1915. Sylvia Pankhurst (1882-1960). Suffragette, militante socialiste et anti-impérialiste britannique. Fille d’Emmeline Pankhurst, elle rejoignit la Women’s Social and Political Union (WSPU) mais s’en éloigna pour critiquer ses méthodes autoritaires et son manque d’attention envers les femmes de la classe ouvrière. Contrairement à sa mère Emmeline et à sa sœur Christabel, elle adopta des positions plus radicales, mêlant lutte pour le suffrage féminin et revendications sociales. Elle fonda l’East London Federation of Suffragettes, combinant lutte pour le droit de vote et revendications sociales. Opposée à la Première Guerre mondiale, elle devint ensuite une figure du communisme et de l’anticolonialisme. Ses dernières années furent consacrées au soutien à l’Éthiopie face à l’occupation italienne.

-
Portrait de Giacomo Matteotti vers 1920. Giacomo Matteotti (1885-1924) .Homme politique italien, membre du Parti socialiste unitaire (PSU). Il se distingua par son opposition vigoureuse au régime fasciste de Benito Mussolini, dénonçant publiquement les violences et les fraudes électorales du fascisme. En mai 1924, après avoir publié un discours accablant contre le gouvernement, il fut enlevé et assassiné par des partisans fascistes. Son meurtre provoqua un scandale national et contribua à l’isolement du régime fasciste, bien que Mussolini parvint à maintenir son pouvoir. L’assassinat de Matteotti reste un symbole de la résistance à la dictature.
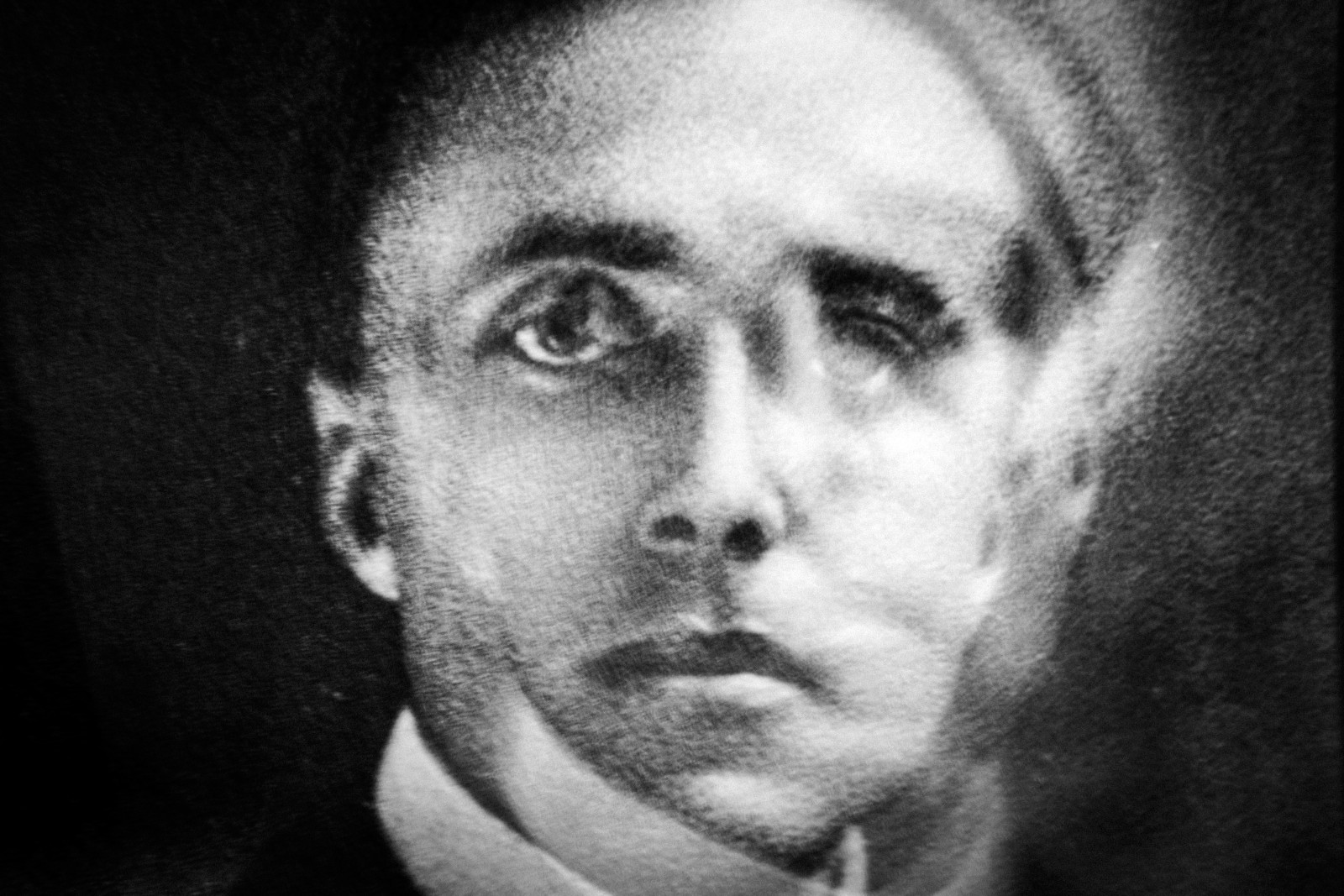
-
Emma Goldman (1869-1940) fut une militante anarchiste et théoricienne politique d’origine lituanienne, active principalement aux États-Unis. Elle critiqua vivement le capitalisme, l’État et les institutions oppressives, tout en défendant la liberté individuelle et la justice sociale. Son engagement comprenait aussi une réflexion sur l’émancipation des femmes, liant anarchisme et féminisme. Elle dénonça le mariage comme institution patriarcale et milita pour le contrôle des naissances. Opposée à l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, elle critiqua vivement le militarisme et organisa des campagnes contre la conscription obligatoire. En 1917, elle fut arrêtée avec Alexander Berkman pour avoir encouragé la résistance à la conscription. Condamnée à deux ans de prison, en 1919, le gouvernement américain, sous la direction de J. Edgar Hoover, l’expulsa vers la Russie avec d’autres activistes lors des Palmer Raids, une vague de répression anticommuniste. Emma Goldman participa brièvement à la révolution russe, mais critiqua rapidement le régime bolchevique pour son autoritarisme.

-
Portrait de Pierre-Joseph Proudhon réalisé par Nadar en 1864. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), philosophe, économiste et théoricien politique français, souvent considéré comme l’un des fondateurs de l’anarchisme. Dans son œuvre principale, Qu’est-ce que la propriété ? (1840), il développe une critique radicale de la propriété privée, qu’il définit comme un instrument d’exploitation, tout en proposant une alternative basée sur le mutualisme. Proudhon prônait une société fondée sur des associations libres, l’échange équitable et l’autogestion, tout en rejetant l’autorité étatique et les structures capitalistes. Bien qu’il fût proche des idéaux républicains et socialistes, il s’opposa à toute forme de centralisation et à l’idée de révolution violente, cherchant à concilier ordre social et liberté individuelle. Son approche, à la fois anticapitaliste et antimilitariste, reste influente dans les courants anarchistes et libertaires.

-
Portrait de Clara Zetkin vers 1890. Clara Zetkin (1857-1933). Militante socialiste, journaliste et théoricienne politique allemande, figure centrale du mouvement ouvrier et féministe. Après avoir milité dans la social-démocratie, elle rejoignit le mouvement communiste, défendant l’émancipation des femmes comme partie intégrante de la lutte des classes. En 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, elle proposa la Journée internationale des femmes. Élue au Reichstag sous le Parti communiste, elle combattit vigoureusement le fascisme jusqu’à sa mort en exil.

-
Portrait de Georges Sorel réalisé au debut du XX siécke. Georges Sorel (1847-1922) fut un philosophe et théoricien politique français, connu pour ses idées sur le syndicalisme révolutionnaire. Critique du parlementarisme et du réformisme socialiste, il développa une pensée axée sur l’action directe et le rôle du mythe social”, un récit mobilisateur capable d’unir les masses autour d’une action collective qui (Réflexions sur la violence,1908). Sorel voyait dans la grève générale un outil clé pour renverser le capitalisme. Son influence, ambivalente, marqua à la fois le mouvement ouvrier radical et certains courants nationalistes.

-
Portrait deJules Guesde réaliser avant 1910 probablemant par les ateliers Nadar. Jules Guesde (1845-1922). Journaliste et homme politique français, figure majeure du socialisme marxiste en France. Fondateur du Parti ouvrier français (POF) en 1882, il défendait un socialisme révolutionnaire basé sur la lutte des classes et s’opposait aux réformes modérées. Malgré ses divergences avec Jean Jaurès, il participa au gouvernement d’union sacrée pendant la Première Guerre mondiale en tant que ministre sans portefeuille (1914-1916). Son nom reste associé à une interprétation rigoureuse et doctrinaire du marxisme en France.
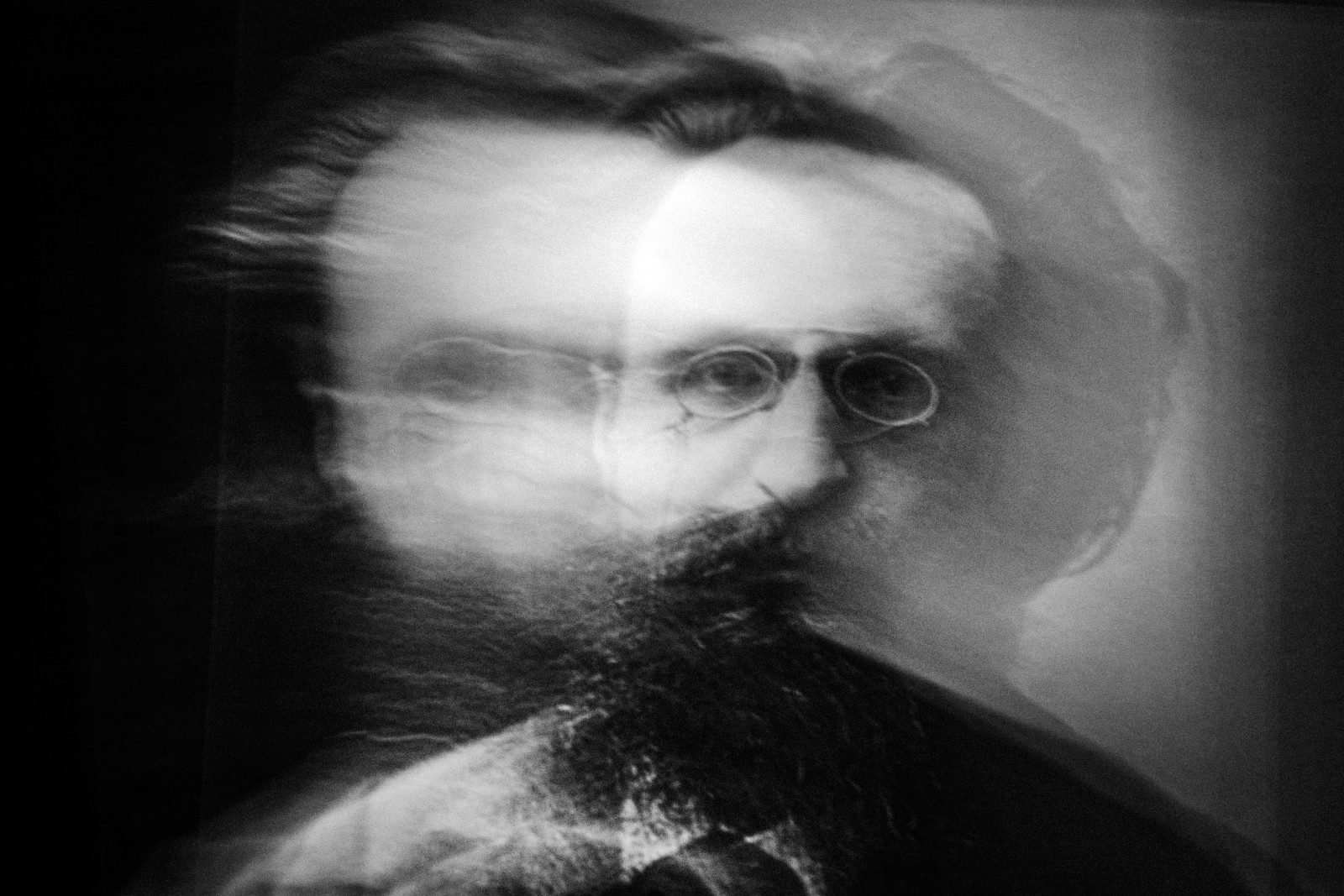
-
Portrait de Alexandra Kollontai vers 1900. Alexandra Kollontaï (1872-1952) Militante marxiste, membre du Parti bolchevique et l’une des premières femmes à occuper des postes gouvernementaux en URSS. Elle développa une réflexion sur le rôle des femmes dans la société socialiste, soulignant l’importance de leur participation économique et politique. À la tête du Zhenotdel, elle travailla à améliorer les conditions de vie des femmes ouvrières et paysannes. Diplomate à partir des années 1920, elle fut également une théoricienne des transformations sociales liées au communisme.
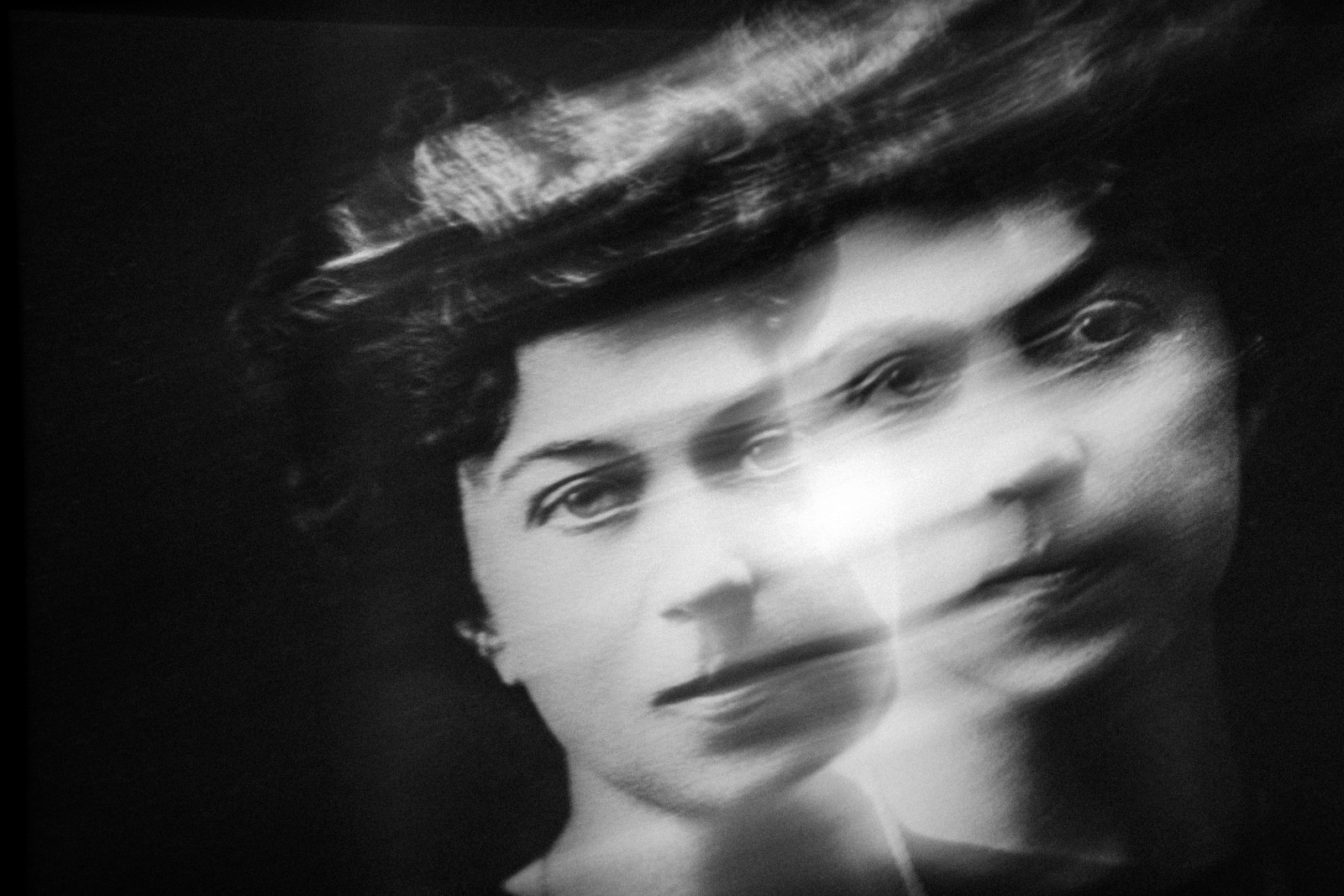
-
Portrait de Eduard Bernstein en 1895. Eduard Bernstein (1850-1932). Théoricien socialiste allemand, figure majeure de la social-démocratie. Initialement proche du marxisme orthodoxe, il développa la théorie du révisionnisme, remettant en question la nécessité d’une révolution violente pour instaurer le socialisme. Dans Les Prémisses du socialisme (1899), il préconisa une évolution progressive par des réformes démocratiques et l’amélioration des conditions de vie des ouvriers. Bien qu’il fut critiqué par les marxistes révolutionnaires comme Rosa Luxemburg, son influence marqua durableme